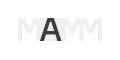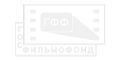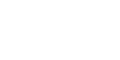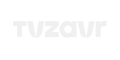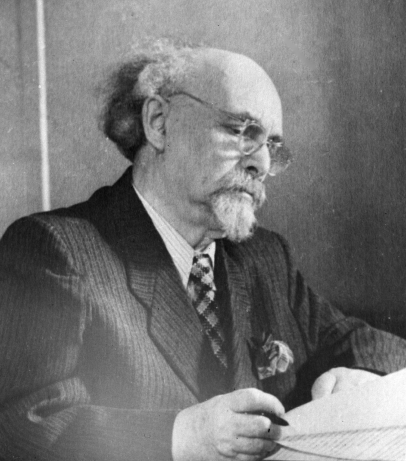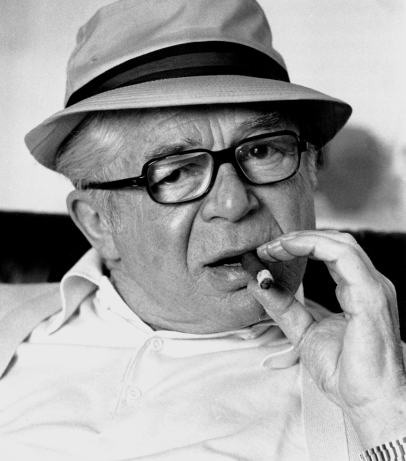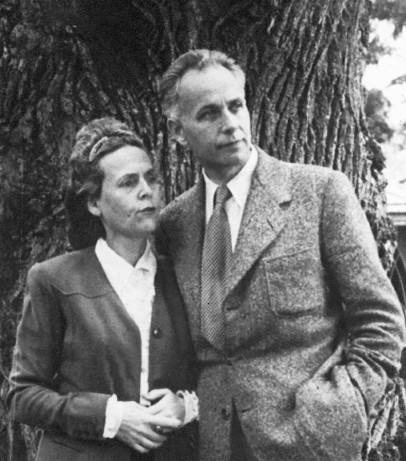Le 6 octobre 1946, avant même la partition de la Palestine, des colonies juives sont créées dans le désert du Néguev dans le but d’assurer la présence juive dans la région.
Dès la fin des années 1930, le Fonds national juif procède à l'achat de terrains dans le Néguev. Avec lui, l'Agence juive, la Haganah (organisation clandestine paramilitaire sioniste en Palestine) et la compagnie des eaux Mekorot lancent une campagne pour coloniser le Néguev dans l'espoir d'intégrer ces territoires dans l'État juif. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1946, les colons établissent des camps dans 11 emplacements au milieu du désert. Entre 1943 et 1947, une vingtaine de colonies agricoles juives y sont créées. Pendant la guerre israélo-arabe de 1948, cette zone est coupée du territoire israélien par les forces égyptiennes, mais à la suite de combats acharnés, Israël reprend le contrôle de la quasi-totalité du territoire historique du désert du Néguev.
Après la guerre, le peuplement rapide du désert du Néguev commence par la construction de canaux d'irrigation. Un certain nombre de «points de développement» sont créés, dont les villes de Dimona, Arad, Ofaqim, Netivot, Yeruham et Mitzpe Ramon. Si dans les colonies créées dans les années 1940 la population se compose principalement de juifs d'Europe, ces «villes de développement» sont destinées à accueillir les juifs séfarades. Le plan des «11 points du Néguev» deviendra l'un des fondements de la construction des infrastructures de l'économie israélienne, et un pilier dans la mise en place de l’État juif.
Source:
Harvey Lithwick, Yehuda Gradus. The Challenge of Industrial Development for Israel's Frontier Cities // Developing Frontier Cities: Global Perspectives — Regional Contexts / Edited by Harvey Lithwick, Yehuda Gradus. — Springer-Science+Business Media, B. V., 2000.